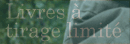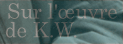Les Vents de Vancouver
Récit.
Traduit de l'anglais par Marie-Claude White.
Marseille, Éditions Le mot et le reste, mars 2014.
Présentation de l'éditeur
Prenant pour point de départ le grand port du Pacifique Nord, Kenneth White trace un itinéraire qui longe le littoral de la Colombie-Britannique avant d’atteindre la péninsule de l’Alaska. En route, dans le style vif et allègre qu’on lui connaît, il esquisse des portraits de coureurs de bois français, d’explorateurs russes, de chercheurs d’or américains, de naturalistes tels que l’Écossais John Muir, tous suivant des pistes d’ombres et de lumières sur fond de vie sauvage, celles des ours et des aigles, des loups et des phoques, et de vie autochtone, celle des Kwakiutls et des Tlingits.
Le résultat est un texte pluridimensionnel, une haute navigation mentale, qui fait voisiner le contexte primordial et la condition moderne.
Prenant pour point de départ le grand port du Pacifique Nord, Kenneth White trace un itinéraire qui longe le littoral de la Colombie-Britannique avant d’atteindre la péninsule de l’Alaska. En route, dans le style vif et allègre qu’on lui connaît, il esquisse des portraits de coureurs de bois français, d’explorateurs russes, de chercheurs d’or américains, de naturalistes tels que l’Écossais John Muir, tous suivant des pistes d’ombres et de lumières sur fond de vie sauvage, celles des ours et des aigles, des loups et des phoques, et de vie autochtone, celle des Kwakiutls et des Tlingits.
Le résultat est un texte pluridimensionnel, une haute navigation mentale, qui fait voisiner le contexte primordial et la condition moderne.
Extraits
« En venant à Vancouver, j’avais en tête toutes sortes d’idées plus ou moins vagues, qui allaient trouver sur place leur configuration, mais, pour commencer, j’avais planifié un itinéraire : un voyage plein de mouvement et de vision, de Vancouver à Seward, via Ketchikan, Wrangell, Juneau, Skagway et Sitka. Avec une logique se déployant graduellement, de façon quiète et secrète, à partir d’une cause fugace ou d’une autre. Lignes marines et lignes mentales. Correspondances cosmographiques. Une initiation, une exitiation. Avec toujours un œil critique sur les choses de ce monde.
Tel était le projet.
Ce que je n’avais pas encore, c’était un bateau. »
Extrait du chapitre « L’élaboration d’un itinéraire »
Trois jours après ma rencontre avec Baird, nous sortions du port de Vancouver en direction du pont de Lions Gate à la sortie de Burrard Inlet (le bras de mer qui sépare la ville en deux), le long d’un rivage jonché de troncs d’arbres. Stanley Park et ses totems à bâbord, Vancouver Ouest à tribord, et un cône de soufre empilé sur un pont qui brillait, jaune vif, dans le soleil du matin :
« Il est transporté par rail depuis l’Alberta, et expédié par bateau depuis Vancouver sur toute la côte du Pacifique », dit Jim.
Nous avons dépassé la coque rouge d’un cargo de la compagnie Hyundai, enregistré à Monrovia, un bateau-pilote de la Seaspan, une barge noire transportant deux grues tirée par un remorqueur, et une flottille de six bateaux de pêche :
« Il y en a de toutes sortes – fileyeurs, senneurs, ligneurs, palangriers. »
En route vers le large.
…
Cap ouest-nord-ouest le long du détroit de Georgie, avec l’intention de faire escale à Bella Coola, où nous comptions passer la nuit. Jim avait quelques affaires à régler là-bas.
Nous nous sommes engagés dans l’étroit bras de mer qui mène à Bella Coola, en longeant de hautes falaises de granit gris-noir, striées par les glaces, et des bosquets de tsugas, d’épinettes de Sitka, de cèdres de l’Ouest. Ici et là, de grands nids échevelés de pygargues à tête blanche, les oiseaux immobiles, ramassés sur eux-mêmes ou déployant leurs longues ailes. Des phoques nageaient, brisant à peine la surface de l’eau. Des loutres de mer nichées dans des paquets d’algues se prélassaient sur le dos, images de l’innocence absolue.
Extrait du chapitre « L’espace s’ouvre »
C’est à un comptoir que Muir rencontra Le Claire, un vieux coureur des bois franco-canadien qui avait à l’époque une mine d’or à la source de Defot Creek et qui était descendu acheter de la farine et du bacon. Le Claire invita Muir à venir dans sa cabane, et celui-ci s’y rendit. Il apprécia plusieurs choses chez Le Claire : sa générosité, sa capacité à porter un lourd fardeau tout en marchant d’un pied léger sur des pistes ardues (la Defot faisait environ soixante-cinq kilomètres), et le fait qu’en dépit des rigueurs d’une vie rude dans des terres difficiles il ait conservé toujours vivace un réel amour de la nature. Le Claire présenta à Muir sa fleur préférée, le myosotis, ainsi que l’une de ses amies intimes, une marmotte au pelage brun moucheté, déjà occupée – « chaque poil et chaque nerf un instrument météorologique » – à emmagasiner ses provisions pour l’hiver. Ils parlèrent dans le « jardin sauvage » du « peuple des plantes » (campanules, géraniums bleus, pieds d’alouette, linnée boréale…) et du « peuple de la montagne » (caribou, ptarmigan), avant d’escalader la crête qui se dressait à l’arrière de la cabane pour contempler le vaste panorama de ce splendide paysage de montagnes jusqu’au coucher du soleil. Ensuite ce fut le dîner, puis les couvertures furent étendues sur le sol, et Le Claire raconta des histoires de sa vie avec les Indiens, les ours, les loups, la neige et la faim.
…
L’un des chasseurs de phoque accepta de faire le guide, et ce fut là que Muir eut son premier contact avec Sit-a-da-kay, alias Glacier Bay, la plus grandiose « congrégation de glaciers » qu’il eût jamais vue. En face de lui se dressaient de hautes falaises de glace qu’il allait nommer le Geikie (d’après James Geikie, le géologiste écossais), le Hugh Miller (un autre géologue écossais), le Pacific, le Muir… Le lendemain étant un dimanche, Young resta au camp à cause de la religion, les Indiens à cause du mauvais temps, et Muir partit seul « pour voir ce qu’[il] pourrait apprendre ». Ce qu’il voulait, c’était avoir une vue globale de toute l’arène. Et il l’eut ce dimanche-là et les jours suivants, tandis qu’il pataugeait sous la pluie et dans la boue, avançait péniblement dans la neige en s’enfonçant jusqu’aux épaules, se frayait un chemin dans des labyrinthes de crevasses, montait jusqu’à plus de quatre mille mètres, écrivait dans son carnet avec ses doigts engourdis. Glacier Bay, ses énormes glaciers et l’étendue de ses eaux emplie d’icebergs, était « une solitude de glace, de neige et de roches, sombre, morne, mystérieuse. » Si, en cette fin d’octobre, la baie était « sombre et morne » (une condition qui n’atténuait en aucune manière l’exaltation de Muir), elle pouvait aussi s’éclairer soudainement et présenter tous les tons de bleus, allant d’une limpidité pâle et chatoyante à une intensité presque criarde. Et une fois, à l’aube, dans un silence profond et immense, rendu encore plus impressionnant par le tonnerre des blocs de glace qui se détachaient par moments du front des glaciers, il vit une étrange lumière cramoisie, surnaturelle, qui devint rouge, puis rose, éclairant les plus hauts sommets de la chaîne, comme si elle sortait de l’intérieur même des montagnes, comme si la matière elle-même était devenue lumière. Pour Muir, l’expérience de Glacier Bay était une fenêtre sur le matin de la création, c’était un monde en gestation (« car le monde, bien que fait, est encore en train de se faire »), un paysage suivant l’autre « dans un rythme et une beauté infinis ».
Extraits du chapitre « Salutation au chef des glaces »
Tandis que je marchais là-haut, je pensais au paysage tel qu’il était avant l’époque de la ruée vers l’or, et à tout ce que cette époque inaugurait : le Gilded Age (la « période dorée » des États-Unis), un capitalisme effréné, un monde diminué.
Elle était là, devant moi, cette immense étendue de nature sauvage, de paysage boréal – un plateau rocheux, des buissons rabougris, des pins tordus par le vent, une terre rouge, ferrugineuse, des étangs glacés, des marais tourbeux, des montagnes d’un bleu fantomatique.
Autrefois foisonnant de caribous, d’ours, d’orignaux et de loups.
La plupart disparus, et d’autres en train de disparaître.
Mais encore la voie des cincles plongeurs, des cygnes siffleurs et des faucons pérégrins, la grande route migratoire connue sous le nom de Pacific Flyway.
Extrait du chapitre « Au sommet du White Pass »
Le lendemain matin, j’ai pris le canot et suis parti explorer la baie.
Le soleil voilé de brume. Le bleu limpide de l’eau. Le beau plumage bigarré d’un arlequin plongeur (bleu, noir, blanc, rouge brun). Des anémones jaunes sur un rocher. Des lichens dorés. Un ruisseau à saumons qui serpente et ondule entre les herbes, la boue et le gravier. Un vol de sternes arctiques. Le chant haut perché du bruant des prés. Un hibou des marais assis sur une branche de peuplier d’Amérique, un œil fermé. Puis, au sommet d’un petit promontoire, un ours à la fourrure fauve qui se régalait céleri sauvage, l’image même de la sérénité et de la satisfaction.
Comme je passais à côté d’un bosquet d’aulnes, un froissement attira mon attention, juste un léger bruissement, rien qui ressemblât au déplacement d’un ours. Je me suis arrêté et j’ai regardé dans le massif. Rien. Puis, alors que je retournais vers le sentier, je l’ai vu, à quelques pas de moi, un carcajou, à la longue fourrure brune, dense, luisante, striée de jaune sur les flancs.
Le carcajou, gulo borealis. Le plus insaisissable de tous les animaux. Une créature solitaire la plus grande partie de l’année, qu’on ne rencontre que dans les lieux les plus reculés. D’une endurance physique à toute épreuve. Qui peut parcourir soixante kilomètres par jour à la recherche de nourriture, et souvent s’en passe. Qui se sent chez lui dans un secteur de cinq cents kilomètres carrés. Et dans un piège, préférera se couper une patte et partir mourir ailleurs plutôt que de rester captif.
Le carcajou me regarda droit dans les yeux, farouche, silencieux, et bondit dans le fourré.
Extrait du chapitre « À bord du Snowbird »
Lire en entier ce dernier chapitre dans La Revue des Ressources
Tel était le projet.
Ce que je n’avais pas encore, c’était un bateau. »
Extrait du chapitre « L’élaboration d’un itinéraire »
Trois jours après ma rencontre avec Baird, nous sortions du port de Vancouver en direction du pont de Lions Gate à la sortie de Burrard Inlet (le bras de mer qui sépare la ville en deux), le long d’un rivage jonché de troncs d’arbres. Stanley Park et ses totems à bâbord, Vancouver Ouest à tribord, et un cône de soufre empilé sur un pont qui brillait, jaune vif, dans le soleil du matin :
« Il est transporté par rail depuis l’Alberta, et expédié par bateau depuis Vancouver sur toute la côte du Pacifique », dit Jim.
Nous avons dépassé la coque rouge d’un cargo de la compagnie Hyundai, enregistré à Monrovia, un bateau-pilote de la Seaspan, une barge noire transportant deux grues tirée par un remorqueur, et une flottille de six bateaux de pêche :
« Il y en a de toutes sortes – fileyeurs, senneurs, ligneurs, palangriers. »
En route vers le large.
…
Cap ouest-nord-ouest le long du détroit de Georgie, avec l’intention de faire escale à Bella Coola, où nous comptions passer la nuit. Jim avait quelques affaires à régler là-bas.
Nous nous sommes engagés dans l’étroit bras de mer qui mène à Bella Coola, en longeant de hautes falaises de granit gris-noir, striées par les glaces, et des bosquets de tsugas, d’épinettes de Sitka, de cèdres de l’Ouest. Ici et là, de grands nids échevelés de pygargues à tête blanche, les oiseaux immobiles, ramassés sur eux-mêmes ou déployant leurs longues ailes. Des phoques nageaient, brisant à peine la surface de l’eau. Des loutres de mer nichées dans des paquets d’algues se prélassaient sur le dos, images de l’innocence absolue.
Extrait du chapitre « L’espace s’ouvre »
C’est à un comptoir que Muir rencontra Le Claire, un vieux coureur des bois franco-canadien qui avait à l’époque une mine d’or à la source de Defot Creek et qui était descendu acheter de la farine et du bacon. Le Claire invita Muir à venir dans sa cabane, et celui-ci s’y rendit. Il apprécia plusieurs choses chez Le Claire : sa générosité, sa capacité à porter un lourd fardeau tout en marchant d’un pied léger sur des pistes ardues (la Defot faisait environ soixante-cinq kilomètres), et le fait qu’en dépit des rigueurs d’une vie rude dans des terres difficiles il ait conservé toujours vivace un réel amour de la nature. Le Claire présenta à Muir sa fleur préférée, le myosotis, ainsi que l’une de ses amies intimes, une marmotte au pelage brun moucheté, déjà occupée – « chaque poil et chaque nerf un instrument météorologique » – à emmagasiner ses provisions pour l’hiver. Ils parlèrent dans le « jardin sauvage » du « peuple des plantes » (campanules, géraniums bleus, pieds d’alouette, linnée boréale…) et du « peuple de la montagne » (caribou, ptarmigan), avant d’escalader la crête qui se dressait à l’arrière de la cabane pour contempler le vaste panorama de ce splendide paysage de montagnes jusqu’au coucher du soleil. Ensuite ce fut le dîner, puis les couvertures furent étendues sur le sol, et Le Claire raconta des histoires de sa vie avec les Indiens, les ours, les loups, la neige et la faim.
…
L’un des chasseurs de phoque accepta de faire le guide, et ce fut là que Muir eut son premier contact avec Sit-a-da-kay, alias Glacier Bay, la plus grandiose « congrégation de glaciers » qu’il eût jamais vue. En face de lui se dressaient de hautes falaises de glace qu’il allait nommer le Geikie (d’après James Geikie, le géologiste écossais), le Hugh Miller (un autre géologue écossais), le Pacific, le Muir… Le lendemain étant un dimanche, Young resta au camp à cause de la religion, les Indiens à cause du mauvais temps, et Muir partit seul « pour voir ce qu’[il] pourrait apprendre ». Ce qu’il voulait, c’était avoir une vue globale de toute l’arène. Et il l’eut ce dimanche-là et les jours suivants, tandis qu’il pataugeait sous la pluie et dans la boue, avançait péniblement dans la neige en s’enfonçant jusqu’aux épaules, se frayait un chemin dans des labyrinthes de crevasses, montait jusqu’à plus de quatre mille mètres, écrivait dans son carnet avec ses doigts engourdis. Glacier Bay, ses énormes glaciers et l’étendue de ses eaux emplie d’icebergs, était « une solitude de glace, de neige et de roches, sombre, morne, mystérieuse. » Si, en cette fin d’octobre, la baie était « sombre et morne » (une condition qui n’atténuait en aucune manière l’exaltation de Muir), elle pouvait aussi s’éclairer soudainement et présenter tous les tons de bleus, allant d’une limpidité pâle et chatoyante à une intensité presque criarde. Et une fois, à l’aube, dans un silence profond et immense, rendu encore plus impressionnant par le tonnerre des blocs de glace qui se détachaient par moments du front des glaciers, il vit une étrange lumière cramoisie, surnaturelle, qui devint rouge, puis rose, éclairant les plus hauts sommets de la chaîne, comme si elle sortait de l’intérieur même des montagnes, comme si la matière elle-même était devenue lumière. Pour Muir, l’expérience de Glacier Bay était une fenêtre sur le matin de la création, c’était un monde en gestation (« car le monde, bien que fait, est encore en train de se faire »), un paysage suivant l’autre « dans un rythme et une beauté infinis ».
Extraits du chapitre « Salutation au chef des glaces »
Tandis que je marchais là-haut, je pensais au paysage tel qu’il était avant l’époque de la ruée vers l’or, et à tout ce que cette époque inaugurait : le Gilded Age (la « période dorée » des États-Unis), un capitalisme effréné, un monde diminué.
Elle était là, devant moi, cette immense étendue de nature sauvage, de paysage boréal – un plateau rocheux, des buissons rabougris, des pins tordus par le vent, une terre rouge, ferrugineuse, des étangs glacés, des marais tourbeux, des montagnes d’un bleu fantomatique.
Autrefois foisonnant de caribous, d’ours, d’orignaux et de loups.
La plupart disparus, et d’autres en train de disparaître.
Mais encore la voie des cincles plongeurs, des cygnes siffleurs et des faucons pérégrins, la grande route migratoire connue sous le nom de Pacific Flyway.
Extrait du chapitre « Au sommet du White Pass »
Le lendemain matin, j’ai pris le canot et suis parti explorer la baie.
Le soleil voilé de brume. Le bleu limpide de l’eau. Le beau plumage bigarré d’un arlequin plongeur (bleu, noir, blanc, rouge brun). Des anémones jaunes sur un rocher. Des lichens dorés. Un ruisseau à saumons qui serpente et ondule entre les herbes, la boue et le gravier. Un vol de sternes arctiques. Le chant haut perché du bruant des prés. Un hibou des marais assis sur une branche de peuplier d’Amérique, un œil fermé. Puis, au sommet d’un petit promontoire, un ours à la fourrure fauve qui se régalait céleri sauvage, l’image même de la sérénité et de la satisfaction.
Comme je passais à côté d’un bosquet d’aulnes, un froissement attira mon attention, juste un léger bruissement, rien qui ressemblât au déplacement d’un ours. Je me suis arrêté et j’ai regardé dans le massif. Rien. Puis, alors que je retournais vers le sentier, je l’ai vu, à quelques pas de moi, un carcajou, à la longue fourrure brune, dense, luisante, striée de jaune sur les flancs.
Le carcajou, gulo borealis. Le plus insaisissable de tous les animaux. Une créature solitaire la plus grande partie de l’année, qu’on ne rencontre que dans les lieux les plus reculés. D’une endurance physique à toute épreuve. Qui peut parcourir soixante kilomètres par jour à la recherche de nourriture, et souvent s’en passe. Qui se sent chez lui dans un secteur de cinq cents kilomètres carrés. Et dans un piège, préférera se couper une patte et partir mourir ailleurs plutôt que de rester captif.
Le carcajou me regarda droit dans les yeux, farouche, silencieux, et bondit dans le fourré.
Extrait du chapitre « À bord du Snowbird »
Lire en entier ce dernier chapitre dans La Revue des Ressources
Presse
De nombreuses impressions et anecdotes composent par aplats ce voyage bien défini, de Vancouver aux glaciers de l’extrême Nord-américain. Nous prenons la route accompagnés de figures historiques à la rencontre de ce qui compose encore ce continent : du trappeur au biologiste, du natif américain au colon, des habitants de l’Alaska aux chauffeurs de taxis pakistanais ; c’est une multitude de visages et de traditions qui peuplent ce récit. Par bonheur pour cet exercice complexe, l’écriture est légère mais précise, les différents portraits sont esquissés d’une façon aussi personnelle que captivante, et c’est un vrai plaisir de suivre les traces de notre explorateur dans les pas de ses prédécesseurs en ces lieux. Le détail de ses rencontres, qu’elles soient de chair ou de papier, nous sont dépeintes avec une réjouissante vitalité qui interpelle à coup sûr. Mais, au-delà des êtres, c’est aussi toute une collection de paysages typiques de cette majesté du grand Nord qui est dépeinte ici. Jamais avare de détails sur la faune et la flore rencontrée, notre voyageur délivre avec une douce précision son vécu et ses émotions face à la nature… le tout accordé comme il se doit au présent comme au passé. Sous-titré "Escales dans l’espace-temps du pacifique Nord" ce récit de voyage en Amérique du Nord, du Canada à l’Alaska, par voies maritimes, ne manque pas cet objectif affiché. Kenneth White sait dépeindre des lieux tout à la fois isolés et pourtant peuplés, avec ce supplément d’humour et de personnalité qui en font un récit unique.
Éva Sinanian, ÉTVDES, Revue de culture contemporaine
Kenneth White nous a déjà emmené dans des contrées blanches et bleues, au Labrador, dans La route bleue (1983, prix Médicis). Il fait d’ailleurs un petit clin d’œil à cette route à la fin de son périple : « Mais, bon, il est temps de reprendre la route, la route sceptique, la route surnihiliste, la route bleue avec ses moments bleus, ses lumières blanches et ses lignes noires et fermes ». Cette fois c’est à l’opposé, à l’ouest du continent américain, que le voyageur et écrivain nous transporte, du côté de Vancouver, le long du Pacifique Nord et des côtes ouest du Canada et de l’Alaska.
…
Un peu comme le Voyage de Vancouver, qui date de 1791, une « histoire écrite sur les vents », White raconte donc ici sa « vadrouille » et ses « escales » dans ces régions, sait nous intéresser, nous faire découvrir ce monde, les lieux, les idées, les pensées, les acteurs, sait nous apprendre, nous donner à comprendre le présent en partant de faits et d’un monde bien réels, mais aussi les cultures du passé, perdues, détruites. Pour garder « tous ses sens ouverts, ainsi que son esprit », rien de mieux que la lecture d’un récit de Kenneth White, à lire si possible au grand air.
Lionel Bedin, La Cause littéraire
On trouve en nos contrées d’Extrême-Occident des géants méconnus, archipoètes, esprits nomades, ou exotes arpentant avec méthode les territoires offerts aux quatre vents. Kenneth White, Écossais installé dans la baie de Lannion, tel un guetteur sur son promontoire, n’a jamais souhaité rejoindre le sérail littéraire français, ses codes et ses petites compromissions quelquefois, préférant l’enchantement de l’académie des goélands aux vains bavardages des têtes vertes et molles.
…
En 1983, La Route bleue (prix Médicis étranger) faisait le récit d’un voyage au Labrador, de Montréal à la baie d’Ungara: «De toute façon, je voulais sortir, aller là-haut, et voir.» Trente ans plus tard, nous parvenons avec Les Vents de Vancouver sur la côte ouest, et partons en bateau avec Lord Jim (Carron Baird), longeant le littoral de la Colombie-Britannique jusqu’à la péninsule de l’Alaska. À l’approche du passage Frederik, près de la région du grand champ de glace de Juneau, «c’était d’une beauté à couper le souffle et d’un calme absolu. Il émanait de ce lieu une sensation d’immensité aux détails parfaits. Le genre de chose que l’on garde dans le tréfonds de son cerveau, tellement précieux et précaire qu’on ne veut pas trop en parler.» L’espace s’ouvre. Des Indiens apparaissent, Chipewyans ou Knisteneaux, de vieux totems recouverts de mousse, des musées perdus: «Je l’ai déjà dit, et je le redirai, si on veut trouver aujourd’hui quelque chose qu’on peut appeler une image cohérente du monde, il faut aller dans un musée et passer un moment à musarder.» Les rencontres les plus improbables, d’aujourd’hui ou d’hier (le naturaliste du siècle des Lumières, Georg Steller) se multiplient, orpailleurs, chasseurs de phoques. Les histoires déferlent, tirées d’ouvrages oubliés (Deux années sur le gaillard d’avant de Richard Henry Dana, 1840). Comédie humaine ou animale. Une annonce sur une porte: «Si notre nourriture, nos boissons et notre service ne sont pas à la hauteur de vos exigences, vous êtes priés de baisser le niveau de vos exigences.»
Fabien Ribery, Le Poulailler, chroniques culturelles du bout du monde
Kenneth White décide d’aller faire un tour dans le nord. Partant de Vancouver il longe la côte ouest pour atteindre l’Alaska, traverse baies glacées, forêts profondes et cantines minables. A chaque arrêt c’est l’occasion de convoquer les voyageurs du passé, un naturaliste écossais et glaciologue amateur, des coureurs des bois, des marchands russes ou encore des baleiniers des siècles passés. On revit la vente de l’Alaska par les Russes aux Américains, une somme folle dépensée pour ce qui n’était à l’époque qu’un immense caillou gelé, depuis le pétrole et les mines ont largement rentabilisé l’investissement. On suit l’établissement des comptoirs dans l’immense territoire canadien pour le commerce des peaux, on grince des dents avec White lorsqu’il nous décrit l’œuvre « civilisatrice » des missionnaires. Mais surtout on s’émerveille de ces étendues encore sauvages, de cette faune et flore unique, on se perd avec le voyageur dans la nature sauvage et fragile.
Avec humour et chaleur, Kenneth White nous brosse un beau tableau des ces contrées froides et on reste fasciné par ce Nord-Ouest encore vivant sous le pouls des pipe-lines.
Librairie Basta, Lausanne
Quel plaisir de repartir à l’aventure avec Kenneth White ! Des côtes de Vancouver à la gigantesque péninsule de l’Alaska, entre conditions actuelles et voyage dans le temps, nous découvrons différentes personnalités, différentes atmosphères. La vie sauvage, la quête d’authenticité et les traditions des peuples amérindiens constituent la trame de ce récit. Avec sa verve habituelle, son humour mais aussi sa poésie, l’auteur nous convie à un dépaysement total... et on en redemande !
Valérie Chatelain, Payot-L'Hebdo, Genève
Éva Sinanian, ÉTVDES, Revue de culture contemporaine
Kenneth White nous a déjà emmené dans des contrées blanches et bleues, au Labrador, dans La route bleue (1983, prix Médicis). Il fait d’ailleurs un petit clin d’œil à cette route à la fin de son périple : « Mais, bon, il est temps de reprendre la route, la route sceptique, la route surnihiliste, la route bleue avec ses moments bleus, ses lumières blanches et ses lignes noires et fermes ». Cette fois c’est à l’opposé, à l’ouest du continent américain, que le voyageur et écrivain nous transporte, du côté de Vancouver, le long du Pacifique Nord et des côtes ouest du Canada et de l’Alaska.
…
Un peu comme le Voyage de Vancouver, qui date de 1791, une « histoire écrite sur les vents », White raconte donc ici sa « vadrouille » et ses « escales » dans ces régions, sait nous intéresser, nous faire découvrir ce monde, les lieux, les idées, les pensées, les acteurs, sait nous apprendre, nous donner à comprendre le présent en partant de faits et d’un monde bien réels, mais aussi les cultures du passé, perdues, détruites. Pour garder « tous ses sens ouverts, ainsi que son esprit », rien de mieux que la lecture d’un récit de Kenneth White, à lire si possible au grand air.
Lionel Bedin, La Cause littéraire
On trouve en nos contrées d’Extrême-Occident des géants méconnus, archipoètes, esprits nomades, ou exotes arpentant avec méthode les territoires offerts aux quatre vents. Kenneth White, Écossais installé dans la baie de Lannion, tel un guetteur sur son promontoire, n’a jamais souhaité rejoindre le sérail littéraire français, ses codes et ses petites compromissions quelquefois, préférant l’enchantement de l’académie des goélands aux vains bavardages des têtes vertes et molles.
…
En 1983, La Route bleue (prix Médicis étranger) faisait le récit d’un voyage au Labrador, de Montréal à la baie d’Ungara: «De toute façon, je voulais sortir, aller là-haut, et voir.» Trente ans plus tard, nous parvenons avec Les Vents de Vancouver sur la côte ouest, et partons en bateau avec Lord Jim (Carron Baird), longeant le littoral de la Colombie-Britannique jusqu’à la péninsule de l’Alaska. À l’approche du passage Frederik, près de la région du grand champ de glace de Juneau, «c’était d’une beauté à couper le souffle et d’un calme absolu. Il émanait de ce lieu une sensation d’immensité aux détails parfaits. Le genre de chose que l’on garde dans le tréfonds de son cerveau, tellement précieux et précaire qu’on ne veut pas trop en parler.» L’espace s’ouvre. Des Indiens apparaissent, Chipewyans ou Knisteneaux, de vieux totems recouverts de mousse, des musées perdus: «Je l’ai déjà dit, et je le redirai, si on veut trouver aujourd’hui quelque chose qu’on peut appeler une image cohérente du monde, il faut aller dans un musée et passer un moment à musarder.» Les rencontres les plus improbables, d’aujourd’hui ou d’hier (le naturaliste du siècle des Lumières, Georg Steller) se multiplient, orpailleurs, chasseurs de phoques. Les histoires déferlent, tirées d’ouvrages oubliés (Deux années sur le gaillard d’avant de Richard Henry Dana, 1840). Comédie humaine ou animale. Une annonce sur une porte: «Si notre nourriture, nos boissons et notre service ne sont pas à la hauteur de vos exigences, vous êtes priés de baisser le niveau de vos exigences.»
Fabien Ribery, Le Poulailler, chroniques culturelles du bout du monde
Kenneth White décide d’aller faire un tour dans le nord. Partant de Vancouver il longe la côte ouest pour atteindre l’Alaska, traverse baies glacées, forêts profondes et cantines minables. A chaque arrêt c’est l’occasion de convoquer les voyageurs du passé, un naturaliste écossais et glaciologue amateur, des coureurs des bois, des marchands russes ou encore des baleiniers des siècles passés. On revit la vente de l’Alaska par les Russes aux Américains, une somme folle dépensée pour ce qui n’était à l’époque qu’un immense caillou gelé, depuis le pétrole et les mines ont largement rentabilisé l’investissement. On suit l’établissement des comptoirs dans l’immense territoire canadien pour le commerce des peaux, on grince des dents avec White lorsqu’il nous décrit l’œuvre « civilisatrice » des missionnaires. Mais surtout on s’émerveille de ces étendues encore sauvages, de cette faune et flore unique, on se perd avec le voyageur dans la nature sauvage et fragile.
Avec humour et chaleur, Kenneth White nous brosse un beau tableau des ces contrées froides et on reste fasciné par ce Nord-Ouest encore vivant sous le pouls des pipe-lines.
Librairie Basta, Lausanne
Quel plaisir de repartir à l’aventure avec Kenneth White ! Des côtes de Vancouver à la gigantesque péninsule de l’Alaska, entre conditions actuelles et voyage dans le temps, nous découvrons différentes personnalités, différentes atmosphères. La vie sauvage, la quête d’authenticité et les traditions des peuples amérindiens constituent la trame de ce récit. Avec sa verve habituelle, son humour mais aussi sa poésie, l’auteur nous convie à un dépaysement total... et on en redemande !
Valérie Chatelain, Payot-L'Hebdo, Genève