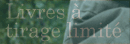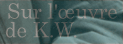La Route bleue
Traduit de l'anglais par Marie-Claude White.
Nouvelle édition, Marseille, Le mot et le reste, 2013.
Préface à la nouvelle édition
Publié en 1983, ce livre célèbre cette année son trentième anniversaire. Au cours de ces années il a été traduit en plusieurs langues. Des individus et des groupes de diverses origines ont suivi cette « route bleue » à leur tour, relatant leur expérience dans des vidéos, des carnets et des livres. Bref, on peut peut-être se risquer à dire que la « route bleue » est en train de devenir, à sa manière, une « voie-de-vie ».
Si je dis « à sa manière », c’est que le livre se situe en dehors du brouhaha habituel, dans un espace à la fois plus large et plus respirant.
De quoi s’agit-il donc ?
De voyage, certes. En termes géographiques, de Montréal au Labrador en longeant la rive nord du Saint-Laurent. Mais d’un voyage plutôt particulier, d’un vagabondage un peu spécial.
« Qui sont-ils, ces voyageurs ? » se demande Rilke dans un des rares grands poèmes du XXe siècle, les Élégies de Duino.
Quand on parle de voyage, surtout dans le contexte américain, la référence la plus fréquente depuis un certain temps est à Sur la route de Jack Kerouac, où la naïveté primaire le dispute au désespoir précoce, en passant par une vague religiosité sentimentale. Mais, restant toujours dans le contexte américain, derrière la route, Highway 66 ou autre, du Breton déboussolé que fut Kérouac, il y a la « route ouverte » de Walt Whitman, le Hollandais planant de Manhattan, qui, au moins au début de son cheminement, sentait l’« esprit du monde » souffler sur l’espace du continent. Cette « route ouverte » s’est fermée à la fin du XIXe siècle, les États-Unis ne connaissant dorénavant, quelques voix dans le désert mises à part, que trivialités criardes et sordides impasses. Mais derrière Whitman, il y a la « route rouge » des premières nations, qui a commencé dans une zone d’ombres et de brumes de l’autre côté du détroit de Bering avant de rencontrer sa fin abrupte et sanglante à Wounded Knee, point culminant du génocide amérindien du ridiculement nommé Nouveau Monde.
Nous approchons là de la route bleue, dont le contexte est un « culturocide » universel, un désastre dont personne, sauf un poète ici et là, n’a jusqu’à présent saisi toutes les coordonnées et encore moins ouvert d’autres perspectives. Cela est dit dans un esprit de clairvoyance froide, sans aucune nostalgie pour d’anciens cadres, d’anciennes identités.
Celui qui voyage sur la route bleue est un « nomade intellectuel ». Le nomade intellectuel a deux cousins : le « loup des steppes » de Hesse, et l’« étranger » de Camus. Mais il a ses spécificités. Le nomade intellectuel n’est ni l’intellectuel platonicien idéaliste, ni l’intellectuel sartrien engagé, ni l’intellectuel médiatique passe-partout qui commente à la petite semaine les événements socio-politiques. Il sort de l’arène, il traverse des territoires physiques, mentaux, culturels, afin d’ouvrir un espace, cet espace que j’ai fini par appeler « géopoétique ». Pas question, bien sûr, de présenter longuement ici le nomadisme intellectuel et la géopoétique. Le lecteur qui voudra pénétrer dans ces domaines de manière plus détaillée pourra se reporter à d’autres livres qui jalonnent mon parcours mental, L’Esprit nomade et Le Plateau de l’Albatros.
Revenons à notre route bleue. Outre, bien sûr, un itinéraire marqué par des incidents, des rencontres, des sensations, comme tout voyage bien conçu, bien vécu, on peut y lire les errances de l’esprit européen depuis la fleur bleue des romantiques, on peut y toucher de près une Amérique d’avant les Etats-Unis, on peut y tracer les lignes d’une topologie inédite.
Si le voyageur de la route bleue est sans idéal et sans engagement immédiat (il sait à quoi mènent les interventions trop hâtives), il est aussi sans espoir, ce qui signifie, en toute logique, qu’il ne peut jamais être désespéré. Son état d’esprit est celui d’une allégresse lucide.
Quand j’étais jeune adolescent sur la côte ouest de l’Écosse, le poète-penseur dont je me sentais le plus proche était un certain John Milton. Dans un de ses essais, ce républicain cosmologue dit ceci : « Nombreux sont ceux qui s’occupent de circonstances, rares ceux qui remontent aux principes. Ô terre, terre, terre ! » Cela m’avait profondément marqué.
Remonter aux principes…
Les principes, ici, sur la route bleue, sont élémentaires, radicaux et extrêmes.
Ils ont pour noms roche, vent, pluie, neige, lumière.
Il s’agit, passage après passage, d’entrer en dernier lieu dans le grand rapport.
C’est sur les routes bleues du monde que recommence, avec tout le reste, la vraie littérature.
K. W.
Côte nord de la Bretagne
Hiver 2013
Publié en 1983, ce livre célèbre cette année son trentième anniversaire. Au cours de ces années il a été traduit en plusieurs langues. Des individus et des groupes de diverses origines ont suivi cette « route bleue » à leur tour, relatant leur expérience dans des vidéos, des carnets et des livres. Bref, on peut peut-être se risquer à dire que la « route bleue » est en train de devenir, à sa manière, une « voie-de-vie ».
Si je dis « à sa manière », c’est que le livre se situe en dehors du brouhaha habituel, dans un espace à la fois plus large et plus respirant.
De quoi s’agit-il donc ?
De voyage, certes. En termes géographiques, de Montréal au Labrador en longeant la rive nord du Saint-Laurent. Mais d’un voyage plutôt particulier, d’un vagabondage un peu spécial.
« Qui sont-ils, ces voyageurs ? » se demande Rilke dans un des rares grands poèmes du XXe siècle, les Élégies de Duino.
Quand on parle de voyage, surtout dans le contexte américain, la référence la plus fréquente depuis un certain temps est à Sur la route de Jack Kerouac, où la naïveté primaire le dispute au désespoir précoce, en passant par une vague religiosité sentimentale. Mais, restant toujours dans le contexte américain, derrière la route, Highway 66 ou autre, du Breton déboussolé que fut Kérouac, il y a la « route ouverte » de Walt Whitman, le Hollandais planant de Manhattan, qui, au moins au début de son cheminement, sentait l’« esprit du monde » souffler sur l’espace du continent. Cette « route ouverte » s’est fermée à la fin du XIXe siècle, les États-Unis ne connaissant dorénavant, quelques voix dans le désert mises à part, que trivialités criardes et sordides impasses. Mais derrière Whitman, il y a la « route rouge » des premières nations, qui a commencé dans une zone d’ombres et de brumes de l’autre côté du détroit de Bering avant de rencontrer sa fin abrupte et sanglante à Wounded Knee, point culminant du génocide amérindien du ridiculement nommé Nouveau Monde.
Nous approchons là de la route bleue, dont le contexte est un « culturocide » universel, un désastre dont personne, sauf un poète ici et là, n’a jusqu’à présent saisi toutes les coordonnées et encore moins ouvert d’autres perspectives. Cela est dit dans un esprit de clairvoyance froide, sans aucune nostalgie pour d’anciens cadres, d’anciennes identités.
Celui qui voyage sur la route bleue est un « nomade intellectuel ». Le nomade intellectuel a deux cousins : le « loup des steppes » de Hesse, et l’« étranger » de Camus. Mais il a ses spécificités. Le nomade intellectuel n’est ni l’intellectuel platonicien idéaliste, ni l’intellectuel sartrien engagé, ni l’intellectuel médiatique passe-partout qui commente à la petite semaine les événements socio-politiques. Il sort de l’arène, il traverse des territoires physiques, mentaux, culturels, afin d’ouvrir un espace, cet espace que j’ai fini par appeler « géopoétique ». Pas question, bien sûr, de présenter longuement ici le nomadisme intellectuel et la géopoétique. Le lecteur qui voudra pénétrer dans ces domaines de manière plus détaillée pourra se reporter à d’autres livres qui jalonnent mon parcours mental, L’Esprit nomade et Le Plateau de l’Albatros.
Revenons à notre route bleue. Outre, bien sûr, un itinéraire marqué par des incidents, des rencontres, des sensations, comme tout voyage bien conçu, bien vécu, on peut y lire les errances de l’esprit européen depuis la fleur bleue des romantiques, on peut y toucher de près une Amérique d’avant les Etats-Unis, on peut y tracer les lignes d’une topologie inédite.
Si le voyageur de la route bleue est sans idéal et sans engagement immédiat (il sait à quoi mènent les interventions trop hâtives), il est aussi sans espoir, ce qui signifie, en toute logique, qu’il ne peut jamais être désespéré. Son état d’esprit est celui d’une allégresse lucide.
Quand j’étais jeune adolescent sur la côte ouest de l’Écosse, le poète-penseur dont je me sentais le plus proche était un certain John Milton. Dans un de ses essais, ce républicain cosmologue dit ceci : « Nombreux sont ceux qui s’occupent de circonstances, rares ceux qui remontent aux principes. Ô terre, terre, terre ! » Cela m’avait profondément marqué.
Remonter aux principes…
Les principes, ici, sur la route bleue, sont élémentaires, radicaux et extrêmes.
Ils ont pour noms roche, vent, pluie, neige, lumière.
Il s’agit, passage après passage, d’entrer en dernier lieu dans le grand rapport.
C’est sur les routes bleues du monde que recommence, avec tout le reste, la vraie littérature.
K. W.
Côte nord de la Bretagne
Hiver 2013
Extraits
Pour les extraits, voir à la première édition (1983).
Presse
Ouvrir la route
Trente ans après, La Route bleue donne toujours autant l’envie de partage le grand décrochement prôné par Kenneth White.
Dans le texte qui explicite le pourquoi de sa décision de fonder, en 1989, l’Institut international de géopoétique, Kenneth White reconnaît que c’est dix ans auparavant, “en voyageant, pérégrinant, déambulant” le long de la côte nord du Saint-Laurent, en route vers la Labrador, que l’idée de la géopoétique lui est venue à l’esprit. Ce voyage, il l’a raconté dans La Route bleue, un livre qui obtint le prix Médicis étranger en 1983, et que rééditent aujourd’hui les éditions Le Mot et le reste. Si ce voyage vers le grand nord, depuis Montréal jusqu’au Labrador, donne corps et réalité à un rêve d’enfant, il découle surtout du désir de sortir, d’échapper au côté étouffant de la culture-clôture qui prévaut dans notre occident moderne et s’interpose entre le monde et nous. Sortir aussi de l’histoire pour entrer dans la géographie, aller vers d’autres expériences de la terre et de la vie. Ouvrir les yeux, voir et sentir, pour sortir du temps, retrouver une relation perdue à un espace premier et à des paysages archaïques. Partir, sauter par-dessus quelques-unes de nos frontières mentales pour se retrouver ailleurs, dans ce qui fut le domaine des Indiens et des Esquimaux. Bien sûr la modernité est passée par là — compagnies minières avalant les collines, grands barrages asséchant les rivières, scieries transformant les forêts en pâte à papier — et les Indiens vivent dans les réserves, mais il est encore de vieux chasseurs avec qui remonter la piste de la mémoire et des chamans qui connaissent encore le chemin d’une autre réalité.
La Route bleue est le journal de ce voyage, avec ses hasards — “Je ne sais pas où je veux aller, mais je suis toujours prêt à me laisser dévier de ma route” —, ses rencontres, ses incidents, le tout entre givre et ciel bleu, lacs et rivières, vent, pluie, neige, ”éclair blanc des bouleaux” et forêt d’érables. L’espace, le chemin, le mouvement, la vie ouverte et mouvante, le ballet des sensations et le sentiment d’évoluer dans un univers où les choses ne sont pas uniquement des choses mais comme de l’être éparpillé dans un beau désordre. Oxygénation de l’être et sentiment d’être merveilleusement vivant. Ces moments nus, l’absolu bonheur d’être là, simplement là, dans l’écoulement du jour et l’intensément réel d’un monde primitif, Kenneth White nous les fait partager comme il nous fait partager la relation qu’il entretient avec ses compagnons fantômes de voyage : Thoreau, qui aurait tant voulu être indien, Melville, et ses “héros ontologiques”, D.H. Lawrence, le “frère”, Nietzsche, Rimbaud, Artaud, “soleils erratiques à la recherche de leur cosmos”, Bashô, maître du haïku. ”Écrire un haïku c’est sauter hors de soi-même, c’est s’oublier et prendre un bon bol d’air frais.
” Lire La Route bleue, ou plutôt la suivre, c’est comprendre ce que qu’est le nomadisme intellectuel, c’est entrer “dans le grand rapport”, celui qui lie la Terre et l’esprit, c’est vivre, au contact de la terre, de l’eau, du vol des oiseaux, de la lumière, des feuilles d’automne ou des seins, bleus ou pas, d’une Pocahontas, une véritable expérience érotique du monde. C’est se retrouver dans des lieux où il est encore possible d’écouter le monde”, c’est entrer dans cette nudité, cette vacuité, cette “ivresse blanche” qui est présence souveraine et plénière au monde, expérience pluridimensionnelle donnant autant à deviner qu’à sentir qu’il est des présences qui nous relient à l’univers ; D’où l’idée qui vint à Kenneth White du concept de géopoétique, “basée sur la trilogie éros, logos et cosmos”, et celle d’un “groupe d’hommes et de femmes venus de toutes les parties du monde, formant un archipel d’esprits ouverts. Non pas tant artistes qu’explorateurs de l’être et du néant. Erratiques et extravagants, à la recherche de nouvelles configurations, à l’écart du champ de la culture ordinaire.”
Richard Blin, Le Matricule des anges, n° 142, avril 2013.
Trente ans après, La Route bleue donne toujours autant l’envie de partage le grand décrochement prôné par Kenneth White.
Dans le texte qui explicite le pourquoi de sa décision de fonder, en 1989, l’Institut international de géopoétique, Kenneth White reconnaît que c’est dix ans auparavant, “en voyageant, pérégrinant, déambulant” le long de la côte nord du Saint-Laurent, en route vers la Labrador, que l’idée de la géopoétique lui est venue à l’esprit. Ce voyage, il l’a raconté dans La Route bleue, un livre qui obtint le prix Médicis étranger en 1983, et que rééditent aujourd’hui les éditions Le Mot et le reste. Si ce voyage vers le grand nord, depuis Montréal jusqu’au Labrador, donne corps et réalité à un rêve d’enfant, il découle surtout du désir de sortir, d’échapper au côté étouffant de la culture-clôture qui prévaut dans notre occident moderne et s’interpose entre le monde et nous. Sortir aussi de l’histoire pour entrer dans la géographie, aller vers d’autres expériences de la terre et de la vie. Ouvrir les yeux, voir et sentir, pour sortir du temps, retrouver une relation perdue à un espace premier et à des paysages archaïques. Partir, sauter par-dessus quelques-unes de nos frontières mentales pour se retrouver ailleurs, dans ce qui fut le domaine des Indiens et des Esquimaux. Bien sûr la modernité est passée par là — compagnies minières avalant les collines, grands barrages asséchant les rivières, scieries transformant les forêts en pâte à papier — et les Indiens vivent dans les réserves, mais il est encore de vieux chasseurs avec qui remonter la piste de la mémoire et des chamans qui connaissent encore le chemin d’une autre réalité.
La Route bleue est le journal de ce voyage, avec ses hasards — “Je ne sais pas où je veux aller, mais je suis toujours prêt à me laisser dévier de ma route” —, ses rencontres, ses incidents, le tout entre givre et ciel bleu, lacs et rivières, vent, pluie, neige, ”éclair blanc des bouleaux” et forêt d’érables. L’espace, le chemin, le mouvement, la vie ouverte et mouvante, le ballet des sensations et le sentiment d’évoluer dans un univers où les choses ne sont pas uniquement des choses mais comme de l’être éparpillé dans un beau désordre. Oxygénation de l’être et sentiment d’être merveilleusement vivant. Ces moments nus, l’absolu bonheur d’être là, simplement là, dans l’écoulement du jour et l’intensément réel d’un monde primitif, Kenneth White nous les fait partager comme il nous fait partager la relation qu’il entretient avec ses compagnons fantômes de voyage : Thoreau, qui aurait tant voulu être indien, Melville, et ses “héros ontologiques”, D.H. Lawrence, le “frère”, Nietzsche, Rimbaud, Artaud, “soleils erratiques à la recherche de leur cosmos”, Bashô, maître du haïku. ”Écrire un haïku c’est sauter hors de soi-même, c’est s’oublier et prendre un bon bol d’air frais.
” Lire La Route bleue, ou plutôt la suivre, c’est comprendre ce que qu’est le nomadisme intellectuel, c’est entrer “dans le grand rapport”, celui qui lie la Terre et l’esprit, c’est vivre, au contact de la terre, de l’eau, du vol des oiseaux, de la lumière, des feuilles d’automne ou des seins, bleus ou pas, d’une Pocahontas, une véritable expérience érotique du monde. C’est se retrouver dans des lieux où il est encore possible d’écouter le monde”, c’est entrer dans cette nudité, cette vacuité, cette “ivresse blanche” qui est présence souveraine et plénière au monde, expérience pluridimensionnelle donnant autant à deviner qu’à sentir qu’il est des présences qui nous relient à l’univers ; D’où l’idée qui vint à Kenneth White du concept de géopoétique, “basée sur la trilogie éros, logos et cosmos”, et celle d’un “groupe d’hommes et de femmes venus de toutes les parties du monde, formant un archipel d’esprits ouverts. Non pas tant artistes qu’explorateurs de l’être et du néant. Erratiques et extravagants, à la recherche de nouvelles configurations, à l’écart du champ de la culture ordinaire.”
Richard Blin, Le Matricule des anges, n° 142, avril 2013.