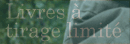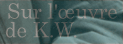Lettres de Gourgounel
Traduit de l'anglais par Gil et Marie Jouanard.
Paris, Presses d’aujourd’hui 1979.
Préface de l'auteur
Me sentant, à une certaine époque, « exilé » comme le vieux Lieu Tsong-yuan, et seul comme un rhinocéros, j’avais cherché un lieu désert où concentrer, du moins pour un temps, ma vie et ma pensée. Je l’ai trouvé là en Ardèche, plus précisément au hameau des Praduches, au lieu-dit Gourgounel (ça gargouillait, ça parlait le langage des sources).
En ce temps-là, l’Ardèche faisait encore partie du « désert français », et je connaissais à peine son existence. J’avais tout au plus quelques vagues souvenirs du voyage dans les Cévennes de mon compatriote Stevenson et j’avais lu dans une biographie de Mallarmé qu’il y avait enseigné un temps l’anglais. Selon Mallarmé, le nom du pays résumait sa vie : l’art et la dèche.
Non pas que ce livre soit en quoi que ce soit mallarméen. Il constitue même un effort pour présenter un espace et une manière d’être au monde complètement différents de « l’espace littéraire » qui est, en France, le legs de Mallarmé. Il n’est pas « stevensonien » non plus. Il se veut moins gentil et esthétique que Stevenson, plus ouvert à des vents fous, avec de l’orage dans l’air et des lumières inédites. Comment qualifier l’espace de ce livre ? Je n’en sais trop rien. J’aimerais seulement qu’on y trouve la saveur du réel, et une poésie rude, sans affectation, sans complication inutile. « Nous voulons être les poètes de notre vie », disait Nietzsche, qui constitue la porte occidentale de ce livre, comme Tchouang-tseu en est la porte orientale.
Me sentant, à une certaine époque, « exilé » comme le vieux Lieu Tsong-yuan, et seul comme un rhinocéros, j’avais cherché un lieu désert où concentrer, du moins pour un temps, ma vie et ma pensée. Je l’ai trouvé là en Ardèche, plus précisément au hameau des Praduches, au lieu-dit Gourgounel (ça gargouillait, ça parlait le langage des sources).
En ce temps-là, l’Ardèche faisait encore partie du « désert français », et je connaissais à peine son existence. J’avais tout au plus quelques vagues souvenirs du voyage dans les Cévennes de mon compatriote Stevenson et j’avais lu dans une biographie de Mallarmé qu’il y avait enseigné un temps l’anglais. Selon Mallarmé, le nom du pays résumait sa vie : l’art et la dèche.
Non pas que ce livre soit en quoi que ce soit mallarméen. Il constitue même un effort pour présenter un espace et une manière d’être au monde complètement différents de « l’espace littéraire » qui est, en France, le legs de Mallarmé. Il n’est pas « stevensonien » non plus. Il se veut moins gentil et esthétique que Stevenson, plus ouvert à des vents fous, avec de l’orage dans l’air et des lumières inédites. Comment qualifier l’espace de ce livre ? Je n’en sais trop rien. J’aimerais seulement qu’on y trouve la saveur du réel, et une poésie rude, sans affectation, sans complication inutile. « Nous voulons être les poètes de notre vie », disait Nietzsche, qui constitue la porte occidentale de ce livre, comme Tchouang-tseu en est la porte orientale.
Extraits
Je m’endors au son du tonnerre, et je m’éveille au son du tonnerre. Le ciel est gris et noir ; les forêts sont vertes, d’un vert presque noir lui aussi.
Je n’ai plus besoin de me laver : le matin, il me suffit de faire un pas au-dehors et de rester nu un moment, debout sous la pluie. Puis je rentre dans la maison, je me frictionne de la tête aux pieds, et, tirant ma chaise contre la maie, je me mets à méditer. En général, il fait jour à demi, et je n’y vois qu’à peine. J’allume parfois une bougie ; d’autres fois, je me contente d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait assez de lumière.
Ce matin, vers cinq heures, il y avait un pic-vert dans les mûriers. J’ignore si c’est là un signe reconnu, mais il me semblait qu’il appelait le tonnerre. Le Tanargue lui répondit un tout petit peu plus tard.
Les Cévennes tout entières tourbillonnent sous les orages.
Extrait du chapitre « Notes cimmériennes »
Il y avait un marchand de chemises à Valgorge ce dimanche-là, et j’avais justement besoin d’une chemise. Il garait sa camionnette et son étalage était placé à côté d’elle. Les chemises, ce n’est pas ce qui lui manquait : des roses, des bleues, des grises, et de toutes les tailles. Lorsque je m’approchai, il n’y avait personne devant l’étalage. « Quelle taille, d’après vous ? » demandai-je au vendeur. « Du deux », répondit-il. Les chemises étaient marquées de un à quatre ; je retirai la mienne et en essayai une marquée « 2 ». Un peu serrée. Je l’ôtai et enfilai du « 3 » : ça allait. J’avais hésité sur le choix de la couleur. Tenté par le rose, puis désignant la bleue, je pris finalement la grise. Et j’ai continué à déambuler dans Valgorge avec ma chemise neuve sur le dos, tenant la vieille à la main.
Au café Rieu, un homme apparut, qui portait un accordéon. Il me cria : « Voulez-vous danser ? »
« Je ne dais pas danser », lui dis-je, et je repris mon chemin en dansant. J’étais juste un peu triste pour l’homme à l’accordéon.
Je ne suis pas un danseur accompli ; je ne connais aucun pas précis, à part le vieux une-deux, une-deux du marcheur ; mais il y a en moi un dieu de la danse, et j’ai l’âme qui danse. Parfois, cela ressemble plus à un pas titubant qu’à une danse, mais c’est quand même un mouvement, vigoureux et enjoué, alors qu’en général les âmes sont molles et ternes ou bien dures comme des pierres. Je suis un danseur, vraiment, mais jamais vous ne me ferez aller dans une salle de bal. Je n’ai aucune envie de suivre l’orchestre ; je me méfie même d’un accordéoniste. Qu’est-ce qui me fait danser, alors ? Eh bien, disons : la musique du monde. Pas l’atmosphère céleste, non tout simplement le monde, le monde ordinaire, le monde terre à terre.
Chapitre « La musique du monde »
Je n’ai plus besoin de me laver : le matin, il me suffit de faire un pas au-dehors et de rester nu un moment, debout sous la pluie. Puis je rentre dans la maison, je me frictionne de la tête aux pieds, et, tirant ma chaise contre la maie, je me mets à méditer. En général, il fait jour à demi, et je n’y vois qu’à peine. J’allume parfois une bougie ; d’autres fois, je me contente d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait assez de lumière.
Ce matin, vers cinq heures, il y avait un pic-vert dans les mûriers. J’ignore si c’est là un signe reconnu, mais il me semblait qu’il appelait le tonnerre. Le Tanargue lui répondit un tout petit peu plus tard.
Les Cévennes tout entières tourbillonnent sous les orages.
Extrait du chapitre « Notes cimmériennes »
Il y avait un marchand de chemises à Valgorge ce dimanche-là, et j’avais justement besoin d’une chemise. Il garait sa camionnette et son étalage était placé à côté d’elle. Les chemises, ce n’est pas ce qui lui manquait : des roses, des bleues, des grises, et de toutes les tailles. Lorsque je m’approchai, il n’y avait personne devant l’étalage. « Quelle taille, d’après vous ? » demandai-je au vendeur. « Du deux », répondit-il. Les chemises étaient marquées de un à quatre ; je retirai la mienne et en essayai une marquée « 2 ». Un peu serrée. Je l’ôtai et enfilai du « 3 » : ça allait. J’avais hésité sur le choix de la couleur. Tenté par le rose, puis désignant la bleue, je pris finalement la grise. Et j’ai continué à déambuler dans Valgorge avec ma chemise neuve sur le dos, tenant la vieille à la main.
Au café Rieu, un homme apparut, qui portait un accordéon. Il me cria : « Voulez-vous danser ? »
« Je ne dais pas danser », lui dis-je, et je repris mon chemin en dansant. J’étais juste un peu triste pour l’homme à l’accordéon.
Je ne suis pas un danseur accompli ; je ne connais aucun pas précis, à part le vieux une-deux, une-deux du marcheur ; mais il y a en moi un dieu de la danse, et j’ai l’âme qui danse. Parfois, cela ressemble plus à un pas titubant qu’à une danse, mais c’est quand même un mouvement, vigoureux et enjoué, alors qu’en général les âmes sont molles et ternes ou bien dures comme des pierres. Je suis un danseur, vraiment, mais jamais vous ne me ferez aller dans une salle de bal. Je n’ai aucune envie de suivre l’orchestre ; je me méfie même d’un accordéoniste. Qu’est-ce qui me fait danser, alors ? Eh bien, disons : la musique du monde. Pas l’atmosphère céleste, non tout simplement le monde, le monde ordinaire, le monde terre à terre.
Chapitre « La musique du monde »
Presse
… ces étranges et jubilantes Lettres de Gourgounel.
Marcel Schneider, Le Figaro littéraire
Ce livre frais, rempli d’odeurs, est un vigoureux dépuratif qui vous requinque et vous change agréablement de la littérature hagarde. Les Lettres de Gourgounel vous éclaircissent l’œil et l’âme. À lire de toute urgence si vous avez le teint brouillé et l’esprit flippant.
Jean-Paul Kauffmann, Le Matin de Paris
Ni bergerie niaise, ni effervescence métaphysique, ni isolement allégorique, le séjour à Gourgounel est à la fois aventure intérieure et aventure terre-à-terre, recueillement et exubérance physique, le tout nappé d’une drôlerie elliptique et familière.
François Nourissier, Le Figaro magazine
Premier ouvrage en prose de Kenneth White, paru à Londres en 1966, les Lettres de Gourgounel livrent déjà l’essentiel du message de l’auteur des Limbes incandescents et, plus récemment, du beau recueil de poèmes Mahamudra. C’est le départ d’une aventure intérieure, contée dans un livre alerte et frais, d’une substance ténue, à peu près sans intrigue, mais dont la progression dramatique tient dans une sorte d’effet cumulatif de présence au réel qui va grandissant, à mesure que s’égrènent les brefs chapitres qui la composent. […] Le résultat, c’est ce livre dense et bref, dont j’aurais peine à dire comme il convient la profonde saveur. On n’en sort pas comme on y est entré. Cela tient pour une bonne part au talent de conteur de White qui sait nous faire participer, comme ses maîtres chinois, à des événements minimes, mais intenses, parce que saisis par lui dans leur absolu furtif.
Roger Munier, Le Monde
Marcel Schneider, Le Figaro littéraire
Ce livre frais, rempli d’odeurs, est un vigoureux dépuratif qui vous requinque et vous change agréablement de la littérature hagarde. Les Lettres de Gourgounel vous éclaircissent l’œil et l’âme. À lire de toute urgence si vous avez le teint brouillé et l’esprit flippant.
Jean-Paul Kauffmann, Le Matin de Paris
Ni bergerie niaise, ni effervescence métaphysique, ni isolement allégorique, le séjour à Gourgounel est à la fois aventure intérieure et aventure terre-à-terre, recueillement et exubérance physique, le tout nappé d’une drôlerie elliptique et familière.
François Nourissier, Le Figaro magazine
Premier ouvrage en prose de Kenneth White, paru à Londres en 1966, les Lettres de Gourgounel livrent déjà l’essentiel du message de l’auteur des Limbes incandescents et, plus récemment, du beau recueil de poèmes Mahamudra. C’est le départ d’une aventure intérieure, contée dans un livre alerte et frais, d’une substance ténue, à peu près sans intrigue, mais dont la progression dramatique tient dans une sorte d’effet cumulatif de présence au réel qui va grandissant, à mesure que s’égrènent les brefs chapitres qui la composent. […] Le résultat, c’est ce livre dense et bref, dont j’aurais peine à dire comme il convient la profonde saveur. On n’en sort pas comme on y est entré. Cela tient pour une bonne part au talent de conteur de White qui sait nous faire participer, comme ses maîtres chinois, à des événements minimes, mais intenses, parce que saisis par lui dans leur absolu furtif.
Roger Munier, Le Monde